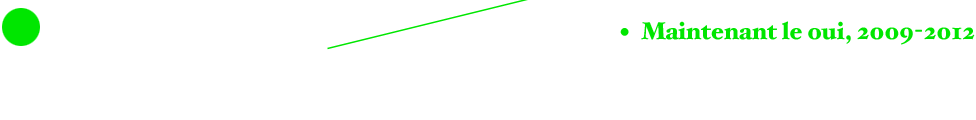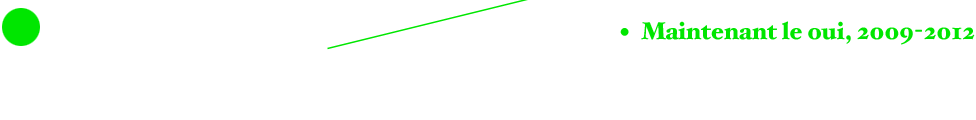Un regard enveloppé d'un drapé vert. Du vert et du noir. Un drapé qui couvre le visage pour ne laisser voir que ce regard dont j'ai oublié les yeux. C'est fou comme il faut que je me concentre pour me souvenir de la couleur des yeux de qui que ce soit ! Toujours un doute. Mon regard fuyant. Vers le monde. Non. Pas son ciel éblouissant où l'œil voyage sans jamais pouvoir se fixer. Non. J'ai regardé le monde d'en bas où l'œil se fixe, où le regard est pris, où le regard se perd, où le regard en arrive parfois à se dégoûter du monde. Et j'ai fermé les yeux.
C'est fou comme on peut se rendre aussi inaccessible qu'une image ! Des visages comme les objets, comme toutes ces images dont les rues sont remplies. Beaucoup de bruit. Des mots sur des images. Et la pensée qui en rajoute. Des mots qui parlent manquent cruellement dans ce brouhaha d'images. J'ai besoin qu'on me parle. J'ai besoin que ça parle.
J'ai pris la parole. J'ai dansé ce que je ne pouvais pas dire. Ma parole ! Je n'ai jamais été aussi seul, non, je ne me suis jamais senti aussi seul qu'en prenant cette parole-là qui manquait cruellement de mots. Comment ai-je pu ne pas pleurer cette solitude intérieure toutes ces années ? Où étaient mes larmes ? Dire qu'elles auraient peut-être obligé ma parole à sortir des chemins où elle se terrait, bien à l'abri de ces regards qui savent écouter. J'ai gardé mes larmes pour ne pas avoir à parler, pour rester une image. Inaccessible. Pour m'enterrer vivant dans avec pour mon mystère.
Donner une parole au silence. Comme si la Loire ne suffisait pas. Comme si l'immensité du ciel et de la mer ne suffisait pas. Comme si un regard ne suffisait pas. Comme si l’orgueil aveuglait.
Je regarde la danse et je parle. Je regarde la vie et je parle. Je dis ce que je vois, crois voire, pense voir ou n'ai pas vu. Prendre le risque de parler. Enfin. Ma parole.
Comment peut-on laisser quelqu'un tranquille quand même il le demande alors qu'il est là, alors que sa présence silencieuse nous appelle et nous intrigue ? Toutes ces fois où je retiens ma parole. Je ne les compte pas. Si encore j’étais trop attentif à laisser la place à la parole d’autrui. Et comment ne pas voir toutes ces fois où l'autre ne me parle que pour se vider, se décharger d'une obligation, d'une politesse, d'un besoin ? Comment ne pas voir toutes ces fois où l'autre me parle sans désir ? Je ne le vois que trop, que je suis trop sensible. Une parole expédiée, même souriante, est une parole expédiée, blessante. Sans retour possible. Une parole prise par le besoin. Comme un chien qui aboie.
J'ai besoin qu'on me parle, que le désir parle. C'est fou comme je retiens encore ce désir que j'ai de parler ! Comme si je n'arrivais pas à lâcher mon jeu avec la folie alors que je n'y crois plus. Comme si le jeu de la danse cherchait encore à se mêler à chacun de mes mots. Comme si j'étais encore pris par ce regard obsédant, par mon regard sur ce regard. Et pourtant, je vois mieux cette obsession du regard qui m'empêche de voir mon désir de dire ce que je vois avec des mots qui parlent, qui s'échangent, se prennent pour d'autres, s'emmêlent, se disputent, s'emballent, s'enthousiasment et voyagent bien au-delà de l'étendue de mon regard.