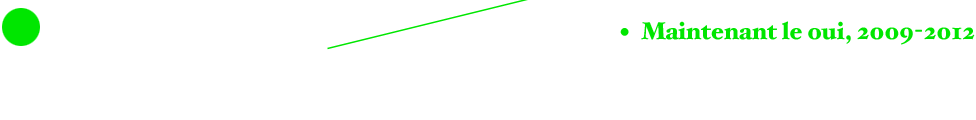Le premier jour. Tu es face à l’étendue muette. Espace. Tu es face au flux et reflux du mouvement des vagues. Tu es dans la lumière, vive. Ciel blanc bleu, chaleur. Tu es en haut d’une falaise et face à toi l’étendue muette. Pas besoin de parler, ici. Le regard sait tout. Le regard, et le corps tendu dressé vers le blanc bleu. Dans la chaleur. Dans l’imminence du saut. Tout le possible face à toi. L’ivresse de le savoir, ou de le sentir, est la première ivresse. Tu la multiplies maintenant par le premier geste. Tu sautes.
Le deuxième jour. Tu refermes les livres. Tu sais que la page est pauvre et morte sans le corps. Tu refermes les livres. Tu oublies tous les noms anciens. Pas la peine. Inutile. Sont avec toi. Tu cesses le combat du refus. Dans l’oubli des livres. Inutile. Dans leur vie effective enfin par le corps et l’ivresse du nouveau geste. Là oui.
Le troisième jour. Tu articules un mot qui entrave ta marche. Tu formes un mot inadéquate qui t’empêche de respirer et te noue bien les jambes entre elles. Tu ne peux plus avancer. Tu manques d’air pour continuer. Le mot formée prend toute la place dans la bouche. Tu ne peux plus l’articuler. Tu ne peux plus parler. Tu ne peux plus marcher. Tu ne peux plus respirer. Cracher le mot. Vite. Cracher le caillot de sang mort qu’est devenu le mot. Cracher la mort une bonne fois. La mâcher. Bien la mâcher. Puis la cracher. Défaire l’entrave. Articuler un nouveau mot. Le même, mais sans le nœud. Maintenant. Le mot défait. Le faire tien. Maintenant. Pouvoir le donner. Ainsi : le mot défait-refait passe d’un corps à l’autre sans qu’il ne soit plus nécessaire à quiconque : ni de faire, ni de défaire, ni de refaire. Maintenant, corps et mots sont ouverts.