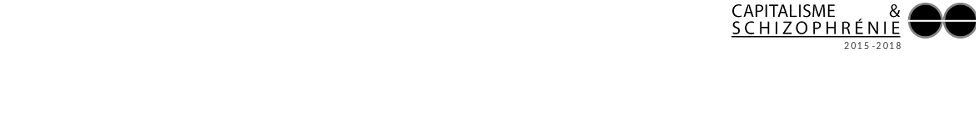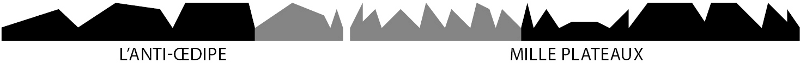Petite blessure — D'un visage l'autre - Pierre-Damien Huyghe & Marie de Quatrebarbes
Dans le plateau « 7. Année zéro, Visagéité », Deleuze et Guattari procèdent à une analyse politique et esthétique du visage, qu’ils pensent comme motif surcodant nos systèmes de perception et de représentation occidentaux. Bien sûr, le visage est blanc, « pierrot lunaire » ou Christ engrammant le Saint-Suaire. Il est « l’Homme blanc moyen », absorbant pour les recouvrir toutes les déviances et les rapporter à l’identique. Dans ce chapitre, le mode de l’injonction prédomine. Deleuze et Guattari exhortent le lecteur à prendre à l’assaut ce « visage-bunker », à le traverser, le renverser, le défaire ; à travers lui, c’est d’abord le langage qui est visé, dans la mesure où il compose la surface de projection, ou de rebond, du signifiant. La façon dont Deleuze et Guattari mobilisent la langue dans ce chapitre est martiale et stratégique. Si cette guerre est sans visage, clandestine, si elle se joue au niveau micro-politique des corps, elle fait appel à tous les outils linguistiques et rhétoriques de la harangue, pour libérer les forces d’opposition nécessaires.
Cette mise à sac, cette guerre, vous m’avez dit un jour qu’elle vous avait, à l’époque de la parution du livre, glacé. Trente-cinq ans plus tard, vous glace-t-elle encore ? Vous m’avez confié qu’à l’injonction belliqueuse vous aviez préféré vous soustraire, vous plaçant de l'autre côté, celui — peut-être — des victimes. Nous étions au café, dehors, et je pensais en vous écoutant à Judith Butler et à la manière dont elle parle des victimes du sida. Nous n’aurions pas pris la mesure de ce qui nous est arrivé collectivement. Nous n’aurions pas évalué à leur juste mesure les conséquences politiques et intimes du sida. Et nous n'aurions pas fini de pleurer nos morts. La guerre en cours est aussi celle des larmes.
L’urgence du deuil a-t-elle aujourd’hui remplacé celle de la guerre ? Mais peut-être que le deuil est une modalité de la guerre.
Dans ma précédente lettre, je vous parlais du visage de celle qui, près de moi, venait de mourir. Quand je relisais le plateau 7 de Mille plateaux l’année dernière, je ne pensais pas tellement au visage du Christ. Le visage de ma grand-mère était ma politique.
Dans son cours du 27 mai 1980, Deleuze dit : « Je repense toujours au mot si satisfaisant de Charlus, dans la Recherche du temps perdu, quand Charlus arrive, pince 2 l’oreille du narrateur et lui dit : "hein ta petite grand-mère tu t’en fous, tu t’en fous canaille ?". D’une certaine manière on en est tous là. Ça ne veut pas dire qu’on ne les aime pas nos grand-mères, nos pères, nos mères, bien sûr on les aime. Mais la question c’est de savoir sous quelle forme et en tant que quoi » (cours « Anti-Œdipe et autres réflexions », du 27/05/1980, transcription Frédéric Astier).
Jusqu’à quel point la ligne de démarcation entre le grand et le petit est-elle tracée ? Et d’ailleurs, qui la trace ? Je pense aux mots de François Zourabichvili dans son Vocabulaire de Deleuze : « Que le cœur batte à la lecture des textes est un préambule nécessaire, mieux encore une affinité requise pour comprendre ; mais ce n’est qu’une moitié de la compréhension, la part, comme dit Deleuze, de la "compréhension non philosophique" des concepts ». Pendant longtemps, j’ai compris cette phrase par la négative — le cœur seul ne suffit pas — jusqu’à finalement renverser mon point de vue : le cœur est déjà la moitié (peut-être la première). Et, pour cette raison, il est suffisant.
Vous m’avez dit, l’autre jour, que vous n’auriez sans doute pas écrit sur Deleuze et Guattari, du moins pas maintenant, pas comme ça, si je ne vous l’avais proposé. De mon côté, je vous ai parlé assez spontanément de ma grand-mère, ce qui est sans doute un peu hors-sujet. Je crois que c'est à cause de la forme de la lettre. Une lettre est une forme banale et fragile. J’écrivais des lettres à ma grand-mère et elle m’en écrivait. Elles parlent de la vie des gens et des pensées qui les traversent. Comme, par exemple, tout à l’heure j’avais l’intention de mettre un poulet au four et, au moment de reproduire ce geste domestique, j’ai remarqué que le cœur gisait sur le sol. Je me souviens qu’un jour ma grand-mère a nettoyé pour moi le squelette entier d’un poulet parce qu'il m'avait semblé beau. Sa forme est temporaire mais, minutieusement nettoyés, les os durent longtemps. Qu’en est-il du cœur ? Je regarde le cœur qui me regarde. « Il est cette petite blessure et la tension de tout ton être pour éviter qu’elle s’étende » (Thierry Trani). Je pense à l’animal auquel il appartenait, à ce corps sur le point d’être pulvérisé dans le mien. Bientôt nous composerons un agencement précaire qui sera soumis à une série de variations, à des transformations, des vitesses. Le cœur reste celui de l’enfance. Il se nourrit du cœur de poulet, de ses os, du visage de la grand-mère, de la présence de certains livres, de la mémoire de certains gestes, des paroles échangées et de quelques moments de solitude.
[Marie de Quatrebarbes]
Oui, je le confirme, la publication de l’Anti-Œdipe, que j’ai lu sur le champ, fut un choc. C’était d’une certaine manière trop fort pour moi. Je note que vous liez aujourd’hui cette information à un autre élément de nos conversations, que vous dîtes concerner le parti des victimes. Était-ce le même jour ? Ai-je dit : « le parti » ? Je vous crois, même si ça ne me semble pas à l’instant le bon mot. En tout cas, je pense bien qu’il reste là quelque chose à penser. Les textes que je connais du couple Deleuze-Guattari ne me sont pas d’un grand secours dans cette tâche. Reste que je vous dois ce qui suit, dans le ton aussi bien que dans la forme de ses treize moments. Et que, lisant votre dernière lettre, celle qui est juste au-dessus (nous ne ferons rien paraître d’autre de nos échanges ni ne dirons leur exacte chronologie, n’est-ce pas ?), je me trouve à vouloir dire (pourquoi, je ne sais au juste) que les victimes ne connaissent pas la défaite propre aux vaincus. Elles ne sont pas guerrières. De là, peut-être, qu’elles résistent finalement plus qu’on ne le croit et qu’elles-mêmes peuvent penser...
1)
Ce texte de Deleuze et Guattari qui m'est confié, comme vous dîtes, puis-je dire si je lai jamais compris ? Non, je suis seulement parvenu, à moitié de son parcours à peu près, à y trouver quelque chose que je pourrai garder par devers moi. C'est cette phrase (p. 16) qui m'a alerté et que j'ai notée parce que vous m'aviez demandé d'écrire : « Bien plus, il est absurde de croire que le langage en tant que tel puisse véhiculer un message. Une langue est toujours prise dans des visages qui en annoncent les énoncés, qui les lestent par rapport aux signifiants en cours ». Je doute de la valeur du « bien plus » mais je discerne dans ce qui le suit, je crois discerner en tout cas, une attaque contre l'idée que tout serait structuré comme un langage. Je me souviens qu'on disait cela de l'Anti-Oedipe, premier ouvrage du couple Deleuze-Guattari : une machine de guerre contre Lacan et au-delà contre la psychanalyse. Le cours que faisait alors Deleuze, désormais consultable via l'internet, en atteste, je l'ai vérifié récemment. Voici en tout cas que ce que Deleuze et Guattari appellent « visage » précède en quelque sorte la langue, voici que ça « leste les signifiants en cours ». Je vais à mon idée d’aujourd’hui (la mienne si j'ose dire, celle que j'ai fait sortir de mon travail en tout cas), à peu près celle-ci : si nous humains tenons au langage, nous tenons aussi à l'insignifiant. Mais leste-t-il le langage cet insignifiant ? Et y a-t-il là pour moi, y a-t-il jamais eu là justification de la politique des lignes de fuite et de la déterritorialisation qui très certainement motive plus qu'elle ne s'en déduit la schizo-analyse que Deleuze et Guattari entendaient soutenir par delà les pratiques analytiques ?
2)
Je conserve les lignes qui suivent – de qui sont-elles ? Pourquoi les ai-je là sur mes notes ? – parce que vous m'avez convaincu de me laisser aller à écrire sans les protocoles professionnels auxquels je me suis habitué. « Après 1979, après 1986. Au cœur même des discours de la normativité et du grondement des crises. Une logique de l’étrangeté appuyée sur l’altération des circuits qui disjonctent : la famille, l’école, le travail, les vacances. Une invention des gestes qui défont et ouvrent juste avant que les grenouilles ne s’endorment ».
3)
Une question me revient à propos de mes écrits, et pas par moi posée, mais qui mentionne justement les « lignes de fuite ». J'ai répondu que cette question même, rapportée comme elle l'était à mon propre travail, m'éclairait sur l'expression de Deleuze. Après tout, pourquoi ne pas chercher le dessin de telles lignes s'il est vrai que la société de contrôle existe ? Mais depuis, ou presque, que j'ai commencé à écrire publiquement, c'est le mot de « soustraction » que je préfère. Pouvoir se soustraire à une obligation, pouvoir soustraire quelque chose à une obligation, ne pas rien soustraire d'un impératif, d'une assignation… Je dis parfois aussi : se sauver, être sauf de se sauver. Rien qui soit là en fait d'un exact pouvoir, plutôt une étrange dynamique, étrange en ceci qu'elle n'ajoute pas mais retire. Puis-je retirer quelque chose d'un ordre qui n'est pas mien mais tend à me prendre, à me déterminer, à me situer, à me localiser ? Localisés, tenus au lieu, interdits d'émancipation, les serfs l'étaient autrefois. Le serions-nous de nouveau, même si autrement qu'eux ? Depuis quelques années, je travaille avec des étudiants qui entendent inscrire quelque chose de leur personne, et souvent déjà le font, au nom du design. À ceux-là, à celles-là j'ai envie de demander (ça ne date pas d'aujourd'hui) qu'ils travaillent à enlever tel et tel élément, tel et tel surcroît dans le monde. Leur tâche consisterait à présenter des situations aussi strictes et dépouillées que possible dans l'allure, appauvries en sollicitations par quoi, divertissantes, elles occupent autrement l'esprit, le réclamant sans qu'il y prenne garde. Partant, ces situations seraient moins excitantes. « Less is more », voilà qui ne va pas de soi. La question n'est pas de vérifier si l'auteur de cette formule avait de bonnes ou de mauvaises raisons personnelles pour la proposer, elle n'est pas non plus de savoir s'il y a été lui-même fidèle ni de quelle manière. Non, ce qui m'est difficile, c'est de m'être aussi un jour mis à penser, en réponse derechef à une question qui m'était adressée, et assez soudainement aussi bien, qu'on pouvait ne pas souhaiter exister la conscience « amortie ». N'est-ce pas cela souvent nos vies courantes, à peine des existences : amortir le surcroît d'excitations caractéristique de la société industrielle qui s'est accomplie désormais en société de consommation ? Ne sommes-nous pas menés à croire, par de nombreux biais, que le mieux pour nous, c'est une vie excitante ? En réalité, ce n'est pas excitante qu'elle est, cette vie, mais excitée. Nous y sommes plus que passibles de quelqu'événement : emportés, passifs. Me sera-t-il jamais possible d'expliquer vraiment ceci : le retrait, la soustraction, le moins peuvent être conditions de l'éveil d'une « haute conscience », comme l'a dit Benjamin à propos de Baudelaire ? Un silence, pourvu qu'il ne soit pas déjà là, mais qu'il se produise, venant en soustraction au bruit des sollicitations, ne peut-il pas faire beaucoup pour l'attention ?
4)
Si le texte de Deleuze et Guattari n'est pas bruyant, du moins bruisse-t-il, et même beaucoup. Il bruisse de bien des mots. Il est florissant, si vous préférez. Il est volubile, disant beaucoup. Par quel visage sa langue est-elle annoncée ? Voici que, lisant, je me souviens d'avoir opéré il y a quelques années un très long séminaire dont l'objectif déclaré était de lire ce qu'avait bien pu écrire Deleuze avant l'Anti-Œdipe. La Logique du sens, donc. Jamais l'objectif ne fut atteint. À la place, une interminable introduction, une lecture toujours annoncée, jamais effectuée. Il m'est alors arrivé de penser (je crois même l'avoir dit alors) que le bébé deleuzien, s'il existait, s'il allait d'une certaine manière exister à partir de l'Anti-Œdipe, était substantiellement tout ouïe, et peu voyant. S'il pouvait bien retenir les signifiants qu'il entendait, il ne voyait guère. Ou ce qu'il voyait ne semblait guère importer. Bien sûr, j'ai travaillé (sur) cette pensée, moi-même pour moi-même, et j'ai pu me dire que cette curieuse idée du bébé deleuzien n'avait pu me traverser l'esprit qu'en guise de refoulement d'une autre, bien plus personnelle (et que je ne connaîtrai ensuite que par analyse, soit en adoptant une conduite et un rapport à l'analyste que je vois mal Deleuze et Guattari valider). Quelle, cette autre idée ? Que pour ma part je ne voulais pas entendre ou ré-entendre ce que j'avais à telle ou telle occasion entendu quand aussi je voyais. Je n'ai de certaines circonstances gardé que la vue. L'ai-je soustraite, cette vue, à sa part peu ou prou signifiante ? Lui ai-je – déjà ? – retiré l'élément audible qui lui aurait permis de faire signe ? Mais que peut bien être ce « je » qui s'imagine si présent dans la question que je viens de poser ? Qui étais-je, moi enfant ? Un prétendant, sans doute, à la subjectivité (c'est du moins ce que je peux dire aujourd'hui). Davantage ? C'est peu probable, encore moins si vous voulez bien considérer que celui auquel je pense actuellement et pour lequel visible et audible ne seraient pas toujours articulés résida un temps dans les parages du bébé.La vue dont un bébé est passible, n'est-ce pas cela le visage et même l’en-deçà du visage que cherche à dire le texte de Deleuze et Guattari ?
5)
Les bébés sont charmants. Rien qui ne me fasse plus plaisir aujourd'hui encore que d'en tenir un dans mes bras et de le sentir, confiant, s'y abandonner, s'y reposer absolument. Rien qui ne m'ait autant soutenu dans ma vie d'adulte que d'avoir pu tenir ainsi les miens. Les « miens » ? Je ne peux me passer de ces petits bouts de phrase : « ma fille », « mes filles », « mes enfants » où peu, très peu, sinon rien de possessif ne se déclare, mais une relation où « je », assurément, se trouve, décentré cependant, passant par un autre, défini lui-même par un nom qui ne le désigne pas. Si je dis « ma fille », en fait je me tourne vers elle, je l'appelle dans sa relation à moi, je ne suis pas seulement, et même assez peu, centré sur ma paternité. J'en parlais à l'improviste, il y a peu, avec un ami trop rarement rencontré. Il a dit ceci : « (…) un amour inconditionnel (...) ».
6)
Sans doute suis-je en train de vous écrire quelques éléments d'une sorte d'Anti-anti-Œdipe. « Mes enfants », ne serait-ce pas le syntagme territorialisant par excellence ? Le revendiquer en motif de bonheur, comme je le fais, n'est-ce pas s'opposer de plain-pied à la logique-Deleuze-Guattari ? Mais si pour ma part, je ne pars pas de ce motif, comment pourrais-je jamais penser franchement ? À l'époque où je lisais les textes que vous me faîtes à présent relire, je ne pouvais appeler mes enfants : ils n'étaient pas nés, et il me faudrait quelques aventures et malheurs avant que cela n'advienne. Mais même alors, mais alors déjà, j'allais avec cet appel. Peut-être serait-il plus juste que je dise qu'il m'appelait lui-même, aussi imparfaitement entendu de moi fût-il sur le moment. J'ai résisté à Deleuze-Guattari avec « ça ». Non que j'aimasse l'enfance en général, je ne trouve guère aimable la mienne, ou par si petites bribes. Justement : j'en cherchais une autre, impossible sûrement à vivre pour moi, mais peut-être pas par moi. Non pas absolument une autre, mais une où pourrait s'inscrire quelque trait qui manquait à celle que je connaissais d'expérience. Non pas mon enfance recommencée, mais une enfance tout de même en relation avec moi, avec moi en relation.
7)
J'ai écrit sur l'enfance, plutôt vers le début de mon écriture publique, des textes à caractère philosophique. Ou, pour dire plus exactement, des textes à caractère psycho-philosophique. La psychanalyse, en tant que champ de propositions conceptuelles, n'en était jamais loin. Je tiens à ces textes, même si je ne les ai pas relus. Dans l'un d'eux, je mettais en relation des phrases où se trouve le mot enfant, des phrases de philosophes classiques, Descartes et Malebranche. Mon propos n'était pas d'expliquer ces phrases mais de produire à partir d'elles, avec elles, grâce à elles, un énoncé spécifique qui, sans doute, me tenait à cœur. En gros, ceci que « enfant » est moins le nom d'un âge ou d'un moment de la vie que d'un état d'esprit qui ne cesse pas d'être aux portes de ce que les classiques auront appelé « conscience ». Cet état a lieu à chaque fois qu'une parole ne peut être articulée. Plus exactement : à chaque fois qu'un élément sans raison énoncée prend le pas de l'esprit. J'osais de ma proposition tirer la conséquence réciproque qu'adulte n'est pas plus qu'enfance un âge déterminé mais, derechef, un état. Qui a l’expérience de la vie est donc encore capable d'enfance ou de naïveté (naïf, nativus : qui vient de naître), peut s'étonner et être étonné quand bien même cet étonnement et cette naïveté ne sont pas, de lui, les qualités les plus demandées. Mais réciproquement, qui n'a pas cette expérience est puissamment rationnel, adulte déjà en puissance. Ou, si vous préférez : la raison est pour lui en dynamique. Descartes et Malebranche parlaient latin mieux que nous. Ils ne pouvaient ignorer la proximité sémantique du mot ratio avec ce que notre français d'aujourd'hui peut appeler « discours ». Ratio, chez l'un comme chez l'autre, est un pôle qui s'oppose à celui de l'infans. Et infans est un nom pour dire : « qui n'a pas la parole ». Je supposais, je suppose que l'opposition ratio / infans est une constante. Et même peut-être la constante de l'existence. Si « ex-(s)ister » veut dire « se situer hors de », sortir d'une situation pour une autre, s'émanciper, alors nous pouvons nous dire existant aussi longtemps que nous sommes capables d'aller et venir d'un pôle à l'autre, tantôt nous soustrayant par un certain exercice du discours à la naïveté infantile, mais tantôt aussi, par occasions (lesquelles, comment à nous présentes ?), nous sauvant de l'empire de la discursivité.
8)
Comprenez-vous que je n'ai jamais ici vraiment quitté le texte de Deleuze et Guattari ? Je le suis au contraire, et j'y reviens, par méandres. Car substantiellement ne traite-t-il pas à sa façon (et moi à la mienne) du bébé, de l'enfant, de l'infans ? C'est-à-dire du fonds. Lisez bien, s'il vous plaît, ce mot avec sa lettre finale, ce « s » qui le constitue en puits sans fin peut-être, en abîme pourquoi pas. Si ce n'était qu'un fond, ce serait une surface inscriptible et justement, l'inscription, Deleuze et Guattari la rejettent. Non qu'ils pensent qu'elle n'existe pas, mais ils en critiquent la discipline. Ainsi lâchent-ils le fameux mot de « déterritorialisation », qui m'a toujours agacé. Le rapport avec le fonds ininscriptible ? C'est assez simple. L'absence de territoire, fût-elle une ligne de fuite, c'est la fin de toute géo-graphie et, par là, de tout ordre graphique. Absence bien tentante au demeurant, et plus radicale, si le mot convient, que la dé-construction derridienne, laquelle mine sans doute les constructions auxquelles elle s'attaque, mais sans jamais les défaire, si « défaire » veut dire « faire disparaître » ou « ôter », mais alors ôter radicalement, ôter au point de trouver le zéro à la fin de l'opération. Bref, pas de dé-construction chez Deleuze et Guattari, mais la proposition d'une fuite (au fait, est-ce fuite ou reflux?) vers une a-graphie (n'est-ce pas un mot qui convient aussi, fût-il moins métaphorique et séduisant que « déterritotialisation »?) aussi totale que possible. Même le visage ramené au minimum de l'envisagement possible, même un visage seulement fait de points et de lignes à peine repérés leur semble de trop, jouant déjà au profit de la territorialisation de la vie.
9)
Où fuit le regard de Deleuze et Guattari si aucun point et si aucune ligne sur aucune surface ne doit jamais le retenir de sombrer dans l'abîme de l'infans ?
10)
À l'instant, avant de vous parler derechef de Deleuze et Guattari, ne cherchant plus à me souvenir de la lettre de mes articles publiés, j'évoquais à votre intention la situation de nos existences entre deux pôles. Puis-je préciser ? D'un côté l'extrême discursivité de la ratio ou, par traduction, du logos (à la limite, le langage comme logique formelle, comme raison délestée de tout ce qui ne serait pas expressément rationnel), de l'autre, au contraire, l'infans, soit, littéralement, je l'ai dit, l'absence de parole. Ou, mieux, bien mieux qu'un nom pour l'absent de la parole, un mot pour l’absent à la parole. Le pôle de l'enfance (ou de la naïveté) comme point extrême de la soustraction à la puissance d'attraction du pôle adverse, celui de l'extrême logique.
11)
Tandis que je vous écris, je n'ai pas près de moi, dans ma bibliothèque, l'Anti-Œdipe. En revanche, je vous l'ai indiqué déjà, j'accède aux notes publiées du cours que faisait Deleuze à l'époque. L'un deux concerne la notion de flux, si importante dans l'Anti-Œdipe et présente, bien sûr aussi, dans Mille plateaux. Pour définir sa notion, Deleuze cite un économiste, je ne sais plus lequel, et lui emprunte cette idée, pour la tourner ensuite à sa façon, qu'un flux est un passage d'un pôle à un autre. Il me semble qu'il s'intéresse beaucoup à l'énergie du passage, à l'intensité des flux, et guère aux pôles, assez statiques au fond dans son propos. Avec les lignes de fuites, il s'agirait de parvenir à produire d'autres pôles, c'est-à-dire, pour lui, des points de passage non encore avérés, pas encore inscrits (on dirait aujourd'hui, si on pensait encore vraiment à ces choses : non cartographiés). Pour ma part, je réfléchis depuis longtemps selon un autre régime métaphorique, celui qui apparaît quand je parle de polarité, celui du champ magnétique. Il faut deux pôles au moins pour que se produise un tel champ, deux pôles relatifs l'un à l'autre. Un pôle n'est pôle qu'en regard d'un autre nécessairement distant. S'il se confondait avec cet autre, le champ exploserait ou imploserait, il n'y aurait plus d'énergie. Et pas davantage de repère. Penser en ces termes, c'est modifier pas mal les choses. Je m'intéresse moins à l'intensité qui flue qu'à la tension par quoi tout ce qui est dans le champ (nos existences, par traduction du schème) se trouve en principe situé. Rien n'est ici que foncièrement tiraillé, di(s)-trait. Mais tout en même temps est susceptible d'un certain équilibre. Certes cet équilibre est toujours instable, toujours inquiet ou toujours, pour reprendre le mot de Pessoa, intranquille. Mais il n'est pas exclu d'être provisoirement ou relativement paisible. Disons : entre, d'un côté, non pas une extrême mais une excessive excitation par un pôle qui, s'il était absolument attirant (ou non contenu en son statut de pôle par un autre), assurerait l'effondrement (collapse) du possible même de la tension, et, de l'autre côté, simple verso au fond, un degré nul de magnétisme, la mort du désir.
12)
Dans la proposition métaphorique que je viens de vous faire, l'image d'un champ au sein duquel nous sommes. Ce champ n'est un espace ni strié ni lisse. C'est un espace, aussi ouvert, aussi infini fût-il, qui s'éprouve de l'intérieur. Je le précise parce que je voudrais que vous lisiez maintenant avec moi cet extrait du texte de Deleuze et Guattari où, en guise de commentaire, je vais souligner (vous le verrez aux italiques qui seront alors mon fait) deux ou trois détails de l'expression par quoi peuvent se lire le refus du concentrique, de l'enroulement et, par extension, de l'opération interne (une soustraction est une telle opération, mais sûrement pas le tracé d'une ligne de fuite). Voici :
« Nous avons vu les deux états très différents de la machine abstraite : tantôt prise dans les strates où elle assure des déterritorialisations seulement relatives, ou bien des déterritorialisations absolues qui restent pourtant négatives ; tantôt au contraire développée sur un plan de consistance qui lui confère une fonction « diagrammatique », une valeur de déterritorialisation positive, comme la force de former de nouvelles machines abstraites. Tantôt la machine abstraite, en tant qu'elle est de visagéité, va rabattre les flux sur des signifiances et des subjectivations, sur des nœuds d'arborescence et des trous d'abolition ; tantôt au contraire, en tant qu'elle opère une véritable « dévisagéification », elle libère en quelque sorte des têtes chercheuses qui défont sur leur passage les strates, qui percent les murs de signifiance et jaillissent des trous de subjectivité, abattent les arbres au profit de véritables rhizomes, et pilotent les flux sur des lignes de déterritorialisation positive ou de fuite créatrice. Il n'y a plus de strates organisées concentriquement, il n'y a plus de trous noirs autour desquels les lignes s'enroulent pour les border, plus de murs où s'accrochent les dichotomies, les binarités, les valeurs bipolaires. Il n'y a plus un visage qui fait redondance avec un paysage, un tableau, une petite phrase musicale, et où perpétuellement l'un fait penser à l'autre, sur la surface unifiée du mur ou dans le tournoiement central du trou noir » (p. 232-233 de votre extrait).
13)
Je crois avoir toujours craint que ne se retourne, et violemment, pareil propos. Paradoxalement, cette crainte ne s'est pas amplifiée, mais sa dimension d'anxiété a diminué lorsque j'ai lu le livre de Weinzman, À travers les murs. Il y aurait à dire encore, bien sûr, depuis le seul extrait que je viens de faire du texte de Deleuze et Guattari. Par exemple, la façon, par le fait du discours seulement justifiée, de lier dans le même mouvement de phrase « dichotomies » et « valeurs bipolaire ». Par exemple encore l'équivalence, fonctionnelle pour ainsi dire, mais pas davantage expliquée, qui s'établit entre ces deux métaphores : « la surface unifiée du mur » et « le tournoiement central du trou noir ». Nul point d'équilibre en cela. Et par conséquent, puisqu'il en est ainsi de tout équilibre, aucun point d'inquiétude. Aux tournoiements générateurs de murs s'opposent des déchaînements supposés libératoires de flux chercheurs qui « abattent les arbres au profit des rhizomes ». Je ne sais par ailleurs pas comment comprendre l'idée que ces mêmes têtes « percent les murs de signifiance ». J'hésite : la phrase dit-elle que la signifiance est perçante ou bien que les murs sont d'elles constitués ? Je me garde pour ma part de ce mot de signifiance, par ailleurs lisible aussi chez Meschonnic, où sûrement il n'a pas la même valeur mais où je le lis avec une réserve de même ordre. Au-delà de ces questions textuelles d'interprétation, je vous ai dit mon parti, je vous ai dit ma préférence pour l'insignifiant. C'est un pôle, cet insignifiant dont l'influence me point tout particulièrement pour ma part quand non pas je vois (comme si je décidais toujours de ma vue) mais quand quelque chose, ayant de l'aspect pour moi, me vient au regard. Je ne parle pas de cela – de l'aspect, ce mot m'est cher – sans inquiétude. Tout de même, j'ai le sentiment (je vais tenter dans un instant de vous indiquer comment je me résous à ce mot de « sentiment »), j'ai le sentiment, donc, qu'existe un sensible singulièrement visuel. Ce que je vais vous dire à présent, il faudrait que je m'en explique davantage. Ce sera en l'état très allusif à ce qu'il m'est arrivé de tenter de dire et dont il faudrait peut-être que je vous fasse une autre lettre. Bref, j'appellerais volontiers tel : « visuel » ou « optique » (mais en un très vieux sens de ce mot, un sens d'avant les sciences optiques), le moins de temporalité possible du sensible. Par extension (excusez, je vous prie, le peu d'explication où je vais) : le moins de syntaxe imaginable. Et le fondement du rythme possible. Rythme : espacement du temps. La signification est dans le temps, signifier demande du temps. Le rythme au contraire écarte la temporalité, la distend, la rompt à la rigueur. Vous connaissez mieux que moi la poésie, je n'ai pas besoin d'insister. Pour conclure, provisoirement peut-être, ceci que, tandis que je pensais à votre demande, j'ai lu dans les Notes inutiles d'un poète, Virgilio Giotti, qu'hier encore je ne connaissais pas : « (...) j'ai eu l'impression que chercher à signifier et à être précis avec des mots trouble et détruit la perception sans mot des sentiments, des affections, des sensations ». La « perception sans mot » d'un côté, le langage de l'autre. Entre les deux un être sans doute par le langage concerné, mais par des traits de perception aussi. Or ils le tiennent, ces traits, au dehors des mots. Ils l'émeuvent (é-motion : mouvement hors), ils le focalisent dans un silence de signes. Par eux il est point. Pour lui, ils sont poignants. Il faudrait que je vous dise encore que je les crois à mon tour peu graphiques. Ou plus grammatiques que graphiques. Leur essence cependant n'est pas de produire une ligne de fuite. Ils ne font pas perspective, mais, comme je vous ai dit, aspect. Que le monde manque d'aspect, qu'il soit extrêmement et finalement excessivement logique, très ou trop logiquement dessiné, de part en part relevé en lignes neutralisant les points, c'est le risque.
[Pierre-Damien Huyghe]
en écho à Mille plateaux, plateau 7 - Pierre-Damien Huyghe & Marie de Quatrebarbes - 19 Avril 2018